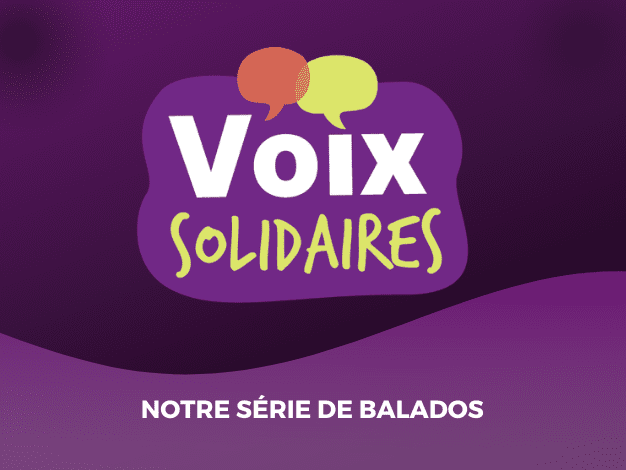
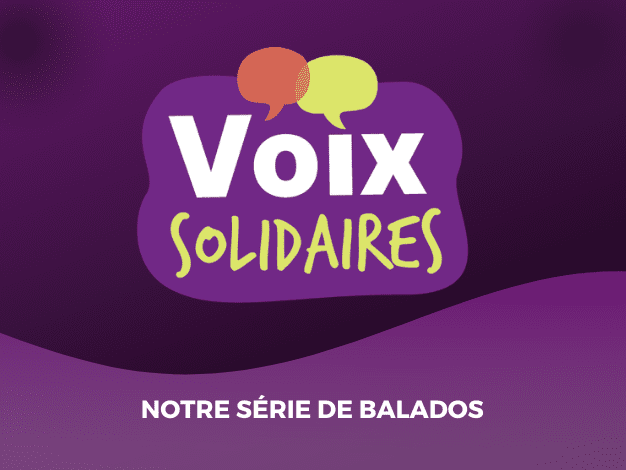
Rejoignez-nous pour amplifier les voix de la justice, célébrer la diversité et faire preuve de solidarité avec les communautés proches et lointaines.
Romina.Acosta-Bimbrera@devp.org
Sans frais : 1 888 234-8533, poste 327
Minaz.Kerawala@devp.org
Sans frais : 1 888 234-8533, poste 328
À propos
Notre travail
Agir
Donner
Ressources
Nous joindre
555, boul. René-Lévesque Ouest, 8e étage
Montréal (Québec) Canada H2Z 1B1
Téléphone : 514 257-8711
Sans frais : 1 888 234-8533
Télécopieur : 514 257-8497
Courriel : info@devp.org
Site Web : www.devp.org
Numéro d’organisme de charité : 1 1882 9902 RR 0001
Notre programme de coopération international est réalisé en partie avec l’appui financier du gouvernement du Canada agissant par l’entremise d’Affaires mondiales Canada.
Développement et Paix – Caritas Canada est l’organisme officiel de solidarité internationale de l’Église catholique au Canada et le membre canadien de Caritas Internationalis.
Copyrights © 2024
Ne manquez rien sur le travail de nos partenaires internationaux ou sur nos campagnes de sensibilisation et de mobilisation.
Inscrivez-vous dès maintenant à notre infolettre.